Lynda Chouiten: une voix originale
Etre écrivain(e) et enseignant chercheur (se) n’est pas toujours ue chose aisée. On connaît beaucoup d’enseignants, dont le but ultime était d’écrire, mais ils savaient bien que la plume ne nourrit pas son homme ; alors, par prudence, ils ont d’abord voulu assurer leurs arrières. Moralité : ils n’ont jamais sauté le pas. Le critique ayant au fil des années pollué le créateur. Et au soir de leur vie, ils sont généralement malheureux, parfois amers. Lynda Chouiten a évité cet écueil. A l’arrivée, une Méditerranéenne comblée. Car elle est reconnue par ses pairs enseignants. Sa thèse sur Isabelle Eberhard démontant le mythe d’une femme iconoclaste réfractaire au pouvoir colonial a été bien accueillie. Sur le plan littéraire, elle s’est distinguée très tôt, puisque son deuxième roman, « Une valse » a obtenu le prix Assia Djebbar. Le jury a sans doute voulu saluer une voix originale sensible à des vies minuscules pour reprendre un titre de l’écrivain Pierre Michon. Car Lynda Chouiten se veut la voix des sans voix et des blessés de la vie. Bonne route l’artiste !
Méditerranéennes : Pouvez- vous, s’il vous plaît, vous présenter à nos lecteurs?
Lynda Chouiten. Native de Tizi-Ouzou, en Algérie, je suis maître de conférences à l’Université de Boumerdes, ville voisine où j’enseigne la littérature. J’ai obtenu mon doctorat – ou plutôt mon PhD – à NUIG : l’Université Nationale d’Irlande à Galway. Ma thèse, qui porte sur la représentation de l’Afrique du Nord dans les écrits d’Isabelle Eberhardt, a été publiée aux Etats-Unis (chez Lexington Books) en novembre 2014. J’ai aussi publié une quinzaine d’articles en français et en anglais et coordonné un ouvrage collectif portant sur l’autorité. Voilà en ce qui concerne mon parcours académique. Mais bien sûr, je suis aussi romancière. Mon premier roman, intitulé Le Roman des Pôv’Cheveux et paru en 2017 aux éditions El Kalima (Algérie), a été finaliste des prix Mohammed Dib et l’Escale d’Alger. En décembre 2019, je remporte le Grand Prix Assia Djebar pour mon deuxième roman Une Valse, paru deux mois plus tôt. A part ça, que dire sinon que j’aime la musique, les voyages, les jeux télévisés et m’amuser avec ma petite nièce – en plus de la lecture et de l’écriture, bien sûr…
Vous êtes enseignante-chercheuse et romancière. Cela suppose deux statuts d’écriture. Comment négociez-vous cette cohabitation scripturaire ?
Dans mes essais, je m’efforce de respecter les codes de l’écriture académique en faisant preuve d’esprit critique et de rigueur dans l’analyse. Je ne sais pas si ces deux qualités se perçoivent dans mes romans, mais ce qui est sûr, c’est que je me sens plus libre dans l’écriture créative, qui permet des audaces tant au niveau du style qu’au niveau de l’imagination.


Vous avez consacré votre thèse à Isabelle Eberhardt. Plusieurs ouvrages ont été écrits sur elle. Quelle est votre apport dans l’ensemble de tous ses ouvrages ?
La plupart des livres consacrés à Eberhardt sont des biographies. Bien que le mien s’intéresse aussi à sa vie – il est impossible de ne pas s’intéresser à une vie aussi atypique – il examine tout aussi minutieusement ses écrits, souvent ignorés parce que jugés de piètre qualité littéraire. A son tour, cette analyse textuelle m’a permis de démonter le mythe d’Eberhardt comme figure iconoclaste et réfractaire à tout système de pouvoir. En effet, j’y défends la thèse qu’elle était plus acquise aux discours colonial et patriarcal de son époque qu’il n’y paraît. J’explique aussi que beaucoup de postures eberhardtiennes étaient mues par une quête de pouvoir, qu’elle prenne la forme d’une participation au projet colonial, d’ambition littéraire ou même d’aspiration à la sainteté !
Le thème de votre premier roman, Le Roman de Pôv’cheveux, est très original. Quand et comment vous est venue l’idée de ce livre? Est-ce une fable?
J’aime à dire que c’est une épiphanie – une sorte de déclic, de révélation. Tout a commencé par une chute de cheveux dont j’ai souffert il y a une quinzaine d’années. Je voyais mes cheveux tomber sur mes habits en m’écriant à chaque fois : « Oh mes pauvres cheveux ! » Et un jour, j’ai pensé, en me lamentant de la sorte, que ça ferait un titre original et intéressant : « Les Aventures d’un Pôv’Cheveu ». Mon jeune frère s’est moqué de moi quand je lui ai fait part de mon idée : Les aventures d’un Cheveu ? Que peut-il s’y passer d’intéressant ? Et j’ai répondu : « plein de choses. Il peut tomber dans une soupe, être poursuivi et persécuté, que sais-je encore ! C’est comme cela que ça a commencé. Progressivement, cette idée de départ s’est ramifiée et le pôv’cheveu est devenu plusieurs pôv’cheveux. Tout un petit monde s’est créé. Ce premier roman est en effet une fable aux dimensions socio-politique et philosophique. Derrière les souffrances des cheveux constamment attachés et malmenés se cache une dénonciation de l’oppression politique ; derrière le regard supérieur posé par l’Humain sur les « personnages capillaires », se trouve une réflexion sur le mépris de classe et de race souvent infligé aux humains eux-mêmes. Et ce ne sont là que deux petits exemples du riche potentiel allégorique des cheveux, pour ainsi dire.
Votre second roman traite de la solitude, de la marginalité et de la folie. Quel lien entre ces deux romans ?
A première vue, il n’y a aucun rapport entre les deux romans. Le premier traite de pauvres cheveux persécutés et le deuxième d’une couturière qui souffre de troubles mentaux et qui rêve d’une valse à Vienne. Mais là encore, il y a plus de similitudes entre les deux qu’il n’y paraît. Les Cheveux, qui sont les personnages principaux du premier roman sont aussi marginalisés et opprimés que Chahira, l’héroïne du deuxième et si Pôv’Cheveu n’est pas fou, il se considère quand même comme un simple d’esprit. Ainsi, dans les deux romans, je me sers d’un personnage « qui ne rentre pas dans le moule » pour jeter un regard critique sur nos sociétés et sur la condition humaine. Il y a d’autres thèmes communs aux deux romans : la différence, la condition féminine, le fanatisme religieux et le Mal, de façon plus générale.
Le titre de votre second roman renvoie au prime abord à la célèbre danse viennoise. Pourquoi?
Le roman raconte l’histoire d’une couturière algérienne qui se qualifie en finale d’un concours de stylisme censé se dérouler à Vienne. En attendant d’y aller, Chahira – c’est le prénom de l’héroïne – tente d’oublier ses ambitions déçues, son environnement misogyne et sa souffrance psychique en rêvant d’une belle valse dans la splendeur de la capitale autrichienne. La célèbre danse viennoise est donc au centre de l’intrigue ; d’où le titre.
Ce roman a été salué sur les réseaux sociaux, à la télévision par des journalistes et des écrivains. Que vous procure cette reconnaissance?
Beaucoup de joie. Il est évident qu’on n’écrit pas pour plaire, mais il ne serait pas honnête de prétendre que la réception de notre œuvre nous est indifférente. Si l’avis des lecteurs n’intéressait pas les écrivains, ils garderaient leurs manuscrits pour eux. En publiant leurs écrits, ils soumettent leur travail à la critique, et ils sont forcément contents quand celle-ci est positive.
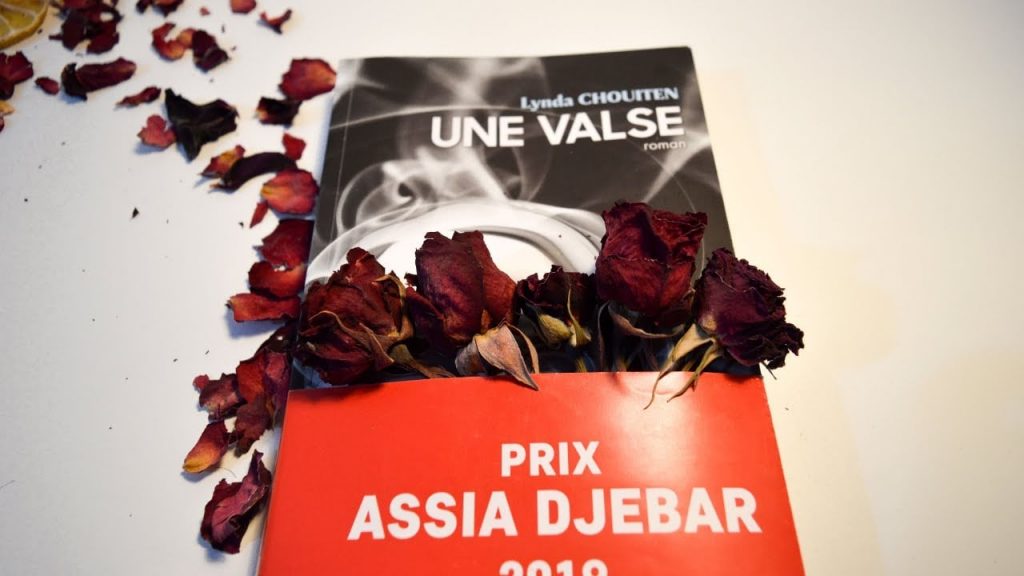
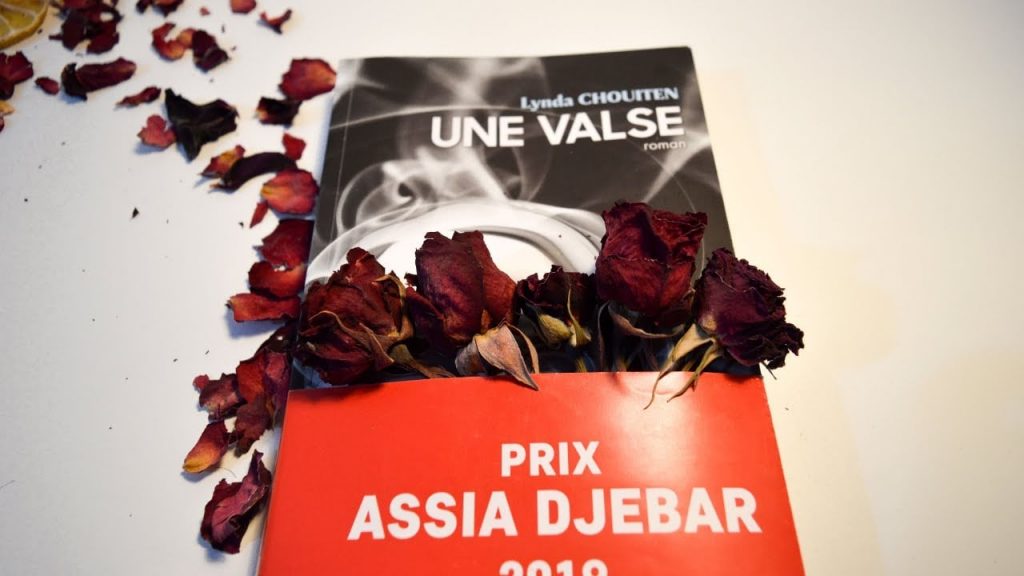
Vos personnages principaux sont des femmes marginales. Dans l’entretien que vous avez donné à Algérie cultures, vous citez Joyce, Thomas Hardy et Tolstoi, comme étant des auteurs qui vous ont marqués. Pour être précis, vous citez leurs textes: Portrait d’un artiste… de Joyce, Anna Karénine de Tolstoï. Est-ce- à dire, qu’aucune écrivaine ne vous sert de référence ?
J’ajouterais aux auteurs que vous avez cités Hans Christian Andersen et Mark Twain. Je n’ai sans doute pas lu suffisamment d’écrivains femmes. Quand j’étais très jeune, je lisais surtout les romancières anglo-saxonnes du 19ème siècle. Enfant, j’adorais Les Quatre filles du Docteur March de Louisa May Alcott ; plus tard, j’ai beaucoup aimé Jane Eyre et les romans de Jane Austen, entre autres, mais aucun de ces textes ne m’a marquée, ne m’a fascinée. Cela est venu bien plus tard, avec la découverte, par exemple, de Virginia Woolf et d’Emily Dickinson, qui me semblent bien plus profondes et plus originales que les écrivaines que j’avais lues jusque-là. Je voudrais juste préciser que mes personnages féminins ne sont pas tous marginaux. Je brosse des portraits féminins différents – celui de la conformiste, de l’artiste, de la timide, de la fonceuse – parce que les femmes sont toutes différentes, tout simplement.
Parlez-nous de vos projets d’écriture, académique et littéraire…
En plus de quelques articles que je traîne depuis longtemps, il y a un projet de traduction vers l’anglais de l’œuvre d’un poète algérien. Ce projet me tient à cœur et pourtant, je n’arrive pas à lui trouver le temps nécessaire. L’idéal serait de pouvoir décrocher une bourse de recherche pour pouvoir m’y consacrer exclusivement, mais ce n’est pas gagné d’avance.
Durant le confinement, j’ai écrit quatre nouvelles et je compte en écrire quatre à six autres pour en faire un recueil. Je projette aussi de publier un recueil de poésie ainsi qu’un conte que j’ai écrit il y a longtemps – j’avais dix-huit ou dix-neuf ans – et que j’ai retrouvé récemment. Pour cela, il faudrait que je reconstitue les quelques pages perdues et aussi que je trouve un bon illustrateur. Enfin, un nouveau roman se dessine tout doucement dans ma tête ; j’espère en entamer l’écriture bientôt.
Quel est votre rapport à la Méditerranée et à notre projet de magazine ?
Dans mon imaginaire, la Méditerranée évoque les belles civilisations antiques des deux rives. Elle a toujours été un point de contact, amical ou brutal, souvent les deux à la fois, entre le « Nord » et le « Sud ». C’est l’espace qui rend toutes les évasions et toutes les rencontres possibles. Je ne peux que saluer chaleureusement un projet qui s’inscrit dans la même perspective, c’est-à-dire qui se veut trait d’union entre les femmes de cette région et qui cherche à instaurer un dialogue autour de leurs préoccupations, leurs combats et leurs espérances.
Propos recueillis par Boniface MONGO MBOUSSA



Commentaires